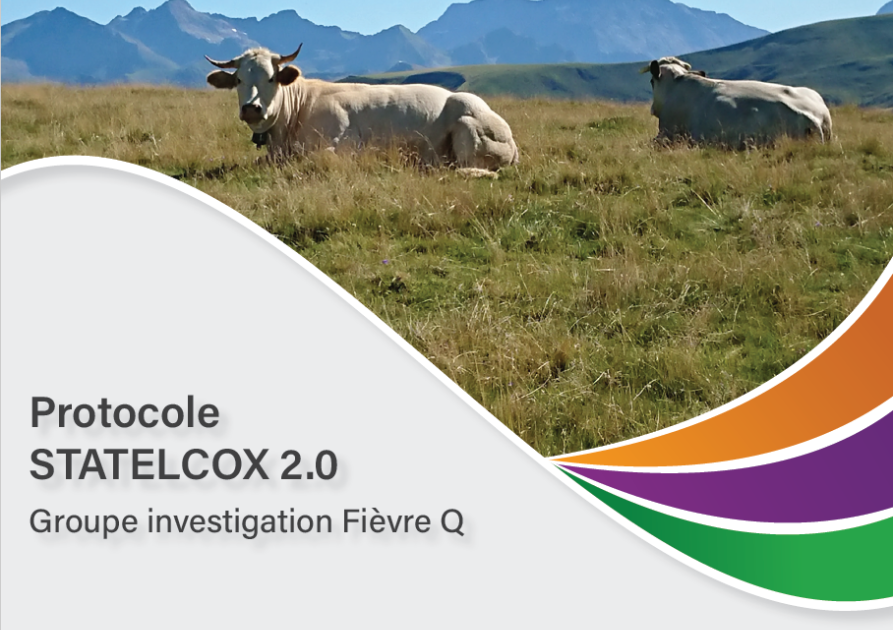La fièvre Q est une maladie affectant l’ensemble des espèces de ruminants provoquée par une bactérie, Coxiella burnetii. Depuis le 21/04/2021, la fièvre Q est classé catégorie E au niveau européen (Loi santé animale). Dans la majorité des cas, les ruminants sont infectés sans présenter de signes cliniques. Dans sa forme clinique, cette maladie entraîne principalement des troubles de la reproduction : avortements en fin de gestation, mises bas prématurées, rétention placentaire, infertilité.
L’épidémie de grande ampleur de fièvre Q en 2007-2010 aux Pays-Bas (plus de 4 000 cas humains), a mis en exergue le potentiel zoonotique de la fièvre Q, et l’importance d’améliorer les connaissances vis-à-vis de cette maladie. Dans ce contexte, le ministère en charge de l’agriculture a décidé la mise en place d’un dispositif de surveillance de cette maladie chez les ruminants en septembre 2012, pour une durée de trois ans dans dix départements (arrêté ministériel (AM) du 13 août 2012).La plateforme ES
La Plateforme ESA a apporté un appui à la surveillance de la Fièvre Q via un groupe projet de 2012 à 2015 (pour plus d'informations sur ce projet allez dans la rubrique "groupes projets associés").
Après la finalisation de ses travaux, le groupe projet avait continué à être sollicité ponctuellement pour apporter un appui scientifique et technique à l'investigation épidémiologique en élevage lors de cas humains groupés de fièvre Q. Le Copil ESA a décidé en 2019 de formaliser cet appui dont l'objectif était différent de celui du groupe projet initialement créé.
Cela a conduit au lancement du groupe investigation Fièvre Q en 2019.
En 2019, le Copil ESA a validé la formalisation d'un groupe investigation dédié à la surveillance de la fièvre Q
Ses Objectifs
- Apporter un appui scientifique et technique à l’investigation épidémiologique en élevage lors de cas humains groupés de fièvre Q ;
- Elaborer une trame de « fiche de cas » pour recenser les mesures de surveillance et gestion mises en place lors des derniers épisodes de cas humains groupés de fièvre Q permettant d’assurer le suivi puis la valorisation des investigations de cas humains groupés. Le volet relatif aux mesures de gestion est traité en dehors du cadre de la Plateforme via des temps de travail dédiés
Le groupe d’investigation Fièvre Q est animé par une experte technique de GDS France. Il regroupe des experts techniques de l'Adilva, Anses, GDS France, Idele, INRAE, IRD, ministère en charge de la santé, ministère en charge de l'agriculture, Oniris, Races de France, Santé Publique France, la SNGTV et VetAgroSup.
Groupe projet Fièvre Q 2012-2015
La Plateforme ESA a été sollicité en 2012 pour apporter un appui au dispositif de surveillance de la fièvre Q. Un groupe projet a été constituer pour répondre à ce besoin
Son objectif
- Élaborer des protocoles de surveillance en élevage
- Produire des documents de communication/sensibilisation à destination des acteurs locaux
- Analyser et interpréter les résultats de la surveillance.
Ce travail s’est finalisé en 2015 avec la publication du « Bilan de la surveillance événementielle et de l’enquête sérologique [Août 2012 – Août 2015] ».
-
Scientific Opinion on Q Fever. EFSA Journal, 8(5):1595. [114 pp.]
-
Recommandations de prise en charge des personnes infectées par Coxiella burnetii, et des personnes exposées à Coxiella burnetii dont les acteurs des filières d’élevage. HCSP, 2013.
-
Rapport relatif aux cas groupés de fièvre Q dans le pays niortais, avril-mai 2017